Tony Poncet, « Le bombardier basque », 1918-1978
Qui n’a jamais vu Tony Poncet sur scène ne peut comprendre ce que signifie une salle qui « croule sous les applaudissements ». Surtout si elle se situait du côté du Midi. Du 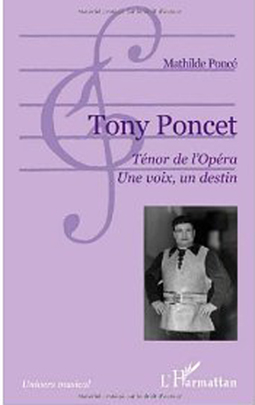 parterre supposé élégant, jusqu’au fin fond du populaire « poulailler », éclataient les mêmes applaudissements, se déclenchaient les mêmes trépignements, jaillissaient les mêmes exclamations. Une onde, sourde et bruyante à la fois, envahissait la salle. Proche de celle d’un tremblement de terre, elle semblait annoncer le prochain effondrement des balcons. Mais personne ne songeait à s’enfuir. La déferlante sonore traversait l’espace pour converger vers un point magnétique : la silhouette, minuscule vue d’en haut, campée fièrement dans la lumière, à l’avant de la scène, attendant stoïquement que tout s’apaise. Tel Jupiter tenant la foudre entre ses mains, il ne pouvait pourtant arrêter cet orage qu’en déclenchant une seconde bourrasque, en bissant, voire en trissant, le grand air que tout le monde avait attendu si longtemps. Cela peut faire sourire, hausser les épaules ou provoquer une moue de dédain. Aucun de ces spectateurs n’a oublié cette ferveur qui les a un jour enveloppés d’un souffle chaud de bonheur. Pire, ou mieux, suivant le point de vue adopté, aucun n’en éprouve la moindre honte. Car, il faut le dire, les censeurs n’ont pas manqué qui ont condamné ce goût pour la prouesse vocale, ce plaisir immédiat, si peu intellectuel. Ils ont cherché toutes les raisons pour dénigrer ce qu’ils considéraient comme la négation même de l’art. Ils n’ont pas réussi à dégoûter les aficionados de Tony Poncet. Sans doute, ont-ils été plus efficaces pour abréger, voire briser sa carrière. Plusieurs décennies plus tard, les orphelins de cette « voix du bon Dieu », ont jalousement gardé les rares microsillons qu’il a laissés et recherchent jusqu’au Japon (extraits de Guillaume Tell, jadis publiés en microsillon par Philips), les reports sur CD dont les firmes françaises se montrent si avares. Mais cet automne, Malibran et Marianne Mélodie, ont publié des rééditions en CD de certaines de ses prestations.
parterre supposé élégant, jusqu’au fin fond du populaire « poulailler », éclataient les mêmes applaudissements, se déclenchaient les mêmes trépignements, jaillissaient les mêmes exclamations. Une onde, sourde et bruyante à la fois, envahissait la salle. Proche de celle d’un tremblement de terre, elle semblait annoncer le prochain effondrement des balcons. Mais personne ne songeait à s’enfuir. La déferlante sonore traversait l’espace pour converger vers un point magnétique : la silhouette, minuscule vue d’en haut, campée fièrement dans la lumière, à l’avant de la scène, attendant stoïquement que tout s’apaise. Tel Jupiter tenant la foudre entre ses mains, il ne pouvait pourtant arrêter cet orage qu’en déclenchant une seconde bourrasque, en bissant, voire en trissant, le grand air que tout le monde avait attendu si longtemps. Cela peut faire sourire, hausser les épaules ou provoquer une moue de dédain. Aucun de ces spectateurs n’a oublié cette ferveur qui les a un jour enveloppés d’un souffle chaud de bonheur. Pire, ou mieux, suivant le point de vue adopté, aucun n’en éprouve la moindre honte. Car, il faut le dire, les censeurs n’ont pas manqué qui ont condamné ce goût pour la prouesse vocale, ce plaisir immédiat, si peu intellectuel. Ils ont cherché toutes les raisons pour dénigrer ce qu’ils considéraient comme la négation même de l’art. Ils n’ont pas réussi à dégoûter les aficionados de Tony Poncet. Sans doute, ont-ils été plus efficaces pour abréger, voire briser sa carrière. Plusieurs décennies plus tard, les orphelins de cette « voix du bon Dieu », ont jalousement gardé les rares microsillons qu’il a laissés et recherchent jusqu’au Japon (extraits de Guillaume Tell, jadis publiés en microsillon par Philips), les reports sur CD dont les firmes françaises se montrent si avares. Mais cet automne, Malibran et Marianne Mélodie, ont publié des rééditions en CD de certaines de ses prestations.
DES DÉBUTS TARDIFS
La carrière, autant que la voix de Tony Poncet, fut atypique. Né près de Murcie, le 26 décembre 1918, Antonio José Ponce Miròn arrive, en 1922, à Bagnères-de-Bigorre, dont il gardera toujours l’accent rocailleux, avec ses parents. Scolarité médiocre, pauvreté qui l’oblige très tôt à divers travaux manuels. Il appartient à une famille sensible au chant et il participe, dès l’âge de 15 ans, à la chorale des Quarante chanteurs montagnards, la plus ancienne formation polyphonique de France, fondée en 1838 par Alfred Roland. A la déclaration de guerre, bien que non mobilisable puisque ressortissant espagnol, il s’engage volontairement dans la Légion. Grièvement blessé dans la Somme, en mai 40 et fait prisonnier, il fera cinq ans de stalag en Bavière et deux tentatives d’évasion. Le chef de camp remarque sa voix et lui propose d’apprendre la musique au Mozarteum de Salzbourg. Il refuse : « Je fais partie d’un pays où les hommes sont fiers et chez moi, mon père s’il apprenait que j’ai chanté pour vous, je crois qu’il me donnerait un coup de fusil. » Les vibrants chants patriotiques qu’il enregistrera en 1960 chez Philips, ne relèvent donc pas d’un simple exercice de style. Il était titulaire de nombreuses décorations (Croix de guerre, Médaille militaire, croix du combattant de l'Europe, croix du combattant volontaire, médaille des engagés volontaires, médaille des blessés de guerre, médaille commémorative de la guerre 39/45, de la Presidential Medal of Freedom américaine). Il était aussi, à titre artistique, Chevalier de la Légion d’honneur et des Arts et lettres. Naturalisé français, celui qui est devenu Antoine Poncé entre au Conservatoire de Paris en 1947 où il côtoie Gabriel Bacquier, Michel Sénéchal, Michel Roux, Liliane Berton. Il fait des petits boulots de nuit pour vivre ou participe aux chœurs des spectacles d’André Dassary ou de Luis Mariano. Il renâcle quelque peu devant le solfège et les chefs d’orchestre devront s’en accommoder. Il dira à un jeune chef qui désirait se mettre d’accord avec lui sur les tempi, avant une représentation de Guillaume Tell : « Ne t’inquiète pas, petit : tu n’as qu’à me suivre. De toute façon, le public vient pour moi et pas pour toi. »
Il fait ses débuts en concert à Lyon en 1953, puis chante à Avignon dans les rôles de Turridu de Cavalleria rusticana et Canio de Paillasse qui restera son rôle fétiche et qu’il chantera environ 200 fois, y compris pour la télévision. En 1954, il participe au concours de ténors, organisé par Mario Podesta à Cannes. À 36 ans, il en est le lauréat, ex-æquo avec Gustave Botiaux, Roger Gardes, Alain Vanzo, Guy Chauvet, 20 ans, obtenant une mention spéciale. La finale diffusée en direct à la radio, permet à Tony Poncet de se faire connaître de la France entière dans le redoutable Di quella pira. Il part pour une tournée aux Etats-Unis, Mexique et Canada. A son retour, c’est la Belgique (Gand, Liège, Bruxelles) qui lui offrent ses premiers succès. En 1957, il débute à l’Opéra-Comique et au Palais Garnier où on le voit dans le Chanteur Italien du Chevalier à la Rose (avec Régine Crespin en Maréchale) ou le Rodolphe de La Bohème (1958), avant d’aborder les rôles lourds des ténors héroïques : Arnold (Guillaume Tell) qu’il incarnera 90 fois, assumant sans défaillir ses 22 contre-ut à chaque prestation ; Eléazar (La Juive) ; Raoul (Les Huguenots), Fernand (La Favorite) ; Vasco de Gama (L’Africaine) ; Don José (Carmen) ; Jean (Hérodiade). On le trouve également dans Le Trouvère, Aïda, Tosca. On pourra le voir sur le petit écran, en 1960, dans Angélique de Jacques Ibert et dans la production De Béthune au chat noir en 1974. Il apparaît, en 1960, au cinéma dans La Pendule à Salomon de Vicky Ivernel.
UNE CARRIÈRE BRÈVE MAIS BRILLANTE
Paris ne programmant guère ses rôles favoris, il claque la porte des théâtres nationaux et chantera désormais essentiellement en Province, en Belgique et en Afrique du Nord : c’est à Alger qu’il chante son premier Radamès en 1960. Il fut invité à chanter Les Huguenots en 1969, année où il se marie, au Carnegie Hall aux côtés de Beverly Sills. Des ennuis de santé l’obligent à s’éloigner de la scène à partir de 1970. Il fut très affecté d’avoir été écarté de l’Opéra de Paris par son nouveau directeur Rolf Liebermann. Sa dernière apparition sur une scène d’opéra date de 1974, au Capitole de Toulouse. Il donnera encore quelques concerts jusqu’en 1977, le dernier en Belgique, avant de mourir, en 1979, à Libourne. Il repose à Saint-Aigulin, en Poitou-Charentes, dans son costume d’Arnold.
Sans complexe, Poncet se comparait aux plus grands, du passé et du présent, considérant avec fierté qu’il avait « deux notes d’aigu de plus » que chacun d’entre eux, y compris Caruso. Il mettait un point d’honneur à interpréter tous les ouvrages dans la tessiture originale, faisant remarquer qu’« aucun ténor que l’on classe parmi les plus grands, Mario del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, ne chante dans le ton (toujours un demi-ton ou un ton en-dessous de la partition) ». Il rêvait de rencontrer les dix meilleurs ténors italiens et de les prends un par un : « Alors on verra bien celui qui chante et ceux qui vocalisent. » Il ajoutait qu’il n’y avait eu que trois ténors en France : « Vezzani, Luccioni et…Poncet. » Cela ne relevait pas de la forfanterie. Il ne donnait pas l’impression d’être imbu de sa personne. S’il était parfois d’une franchise peu diplomatique, il n’écrasait jamais ses partenaires. C’est ainsi qu’à Marseille, il encouragea un jeune baryton, nommé José Van Dam, d’un chaleureux « C’est bien, petit, continue ! ». La conscience qu’il avait de la nature exceptionnelle de sa voix l’obligeait, par honnêteté envers son public, à ne pas s’économiser et à répondre à son attente, avec une générosité jamais prise en défaut. Les auditeurs étaient sensibles à cette sincérité et succombaient au charme d’une voix naturelle, à l’émission saine, qui s’était mesurée aux grondements du Gave et aux espaces des cirques pyrénéens. Son timbre rond et coloré s’épanouissait sur une quinte aiguë éblouissante tant elle semblait atteinte sans effort. Les puristes faisaient la fine bouche. Les doctes critiques le fustigeaient. Le public, surtout celui du « poulailler », jubilait et revenait chaque fois plus nombreux. Il oubliait le comédien inexistant, le ridicule involontaire de sa petite taille confrontée à celle de certaines de ses partenaires tenues de renoncer au moindre talon pour rester à sa hauteur (1,60 m). Il ne lui échappait pas que cette voix était capable de nuances, de diminuendo et rinforzando sur le souffle, du meilleur aloi. Sans même connaître l’étymologie, le spectateur expérimentait ce que le chant doit aux incantations magiques (carmen, carminis) : en l’écoutant, il voyait non plus l’interprète mais le héros qui prenait vie et forme grâce à cette voix unique. Certaines rééditions récentes en CD ne peuvent que combler ces admirateurs.
Mathilde Poncé, qui n’avait que dix ans au décès de son père, a publié : Tony Poncet, Ténor de l’Opéra, une voix, un destin, L’Harmattan, décembre 2009, à l’occasion du trentième anniversaire de sa disparition.
Danielle Pister
